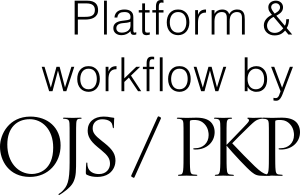Les compétences professionnelles de la médiation culture: D’une invariable indétermination à la reconnaissance située de variables modulationslle au prisme d’une approche écosystémique.
DOI :
https://doi.org/10.25757/invep.v14i2.373Mots-clés :
Politiques publiques, Organisations culturelles, Médiation culturelle de l’art, Écosystème, PublicsRésumé
Bien que les médiateurs culturels de l’art se reconnaissent comme composant un groupe professionnel spécifique et, malgré leurs multiples initiatives de structuration, la reconnaissance de leur profession peine à se produire. Pourtant, leur présence dans les structures artistiques et culturelles est indiscutable, tout comme leur rôle au sein des politiques culturelles.
Hybride, la médiation culturelle de l’art ne connaît pas de définition unique, ni de circonscription stable des disciplines dont elle use. Plutôt qu’une activité professionnelle (dé)limitée, elle recouvre un champ d’activités professionnelles modulable et illimité. « Elle forme plutôt qu’une science, un champ de scientificités[1] ».
Comment dès lors relever le défi de poser des frontières autour d'un ensemble spécifique de savoirs et de compétences, alors même que l’une des caractéristiques de cette activité professionnelle est, justement, de ne cesser d’en moduler les contours, en fonction des situations ? La compétence essentielle à cette profession ne serait-elle pas précisément cette capacité d’agir par le milieu[2] ? Regarder la médiation culturelle de l’art comme un écosystème organique augure une possible reconnaissance de cette profession. En outre, elle propose d’autres manières de considérer la médiation culturelle de l’art et les publics et, plus globalement, d’envisager les politiques publiques.
[1] Suzanne, G. (2022). Esthétique de la médiation. Approche historique, théorique et critique d'une pratique et d’une notion. Aix-en-Provence, Éd. Presses Universitaires de Provence. P. 57.
[2] Deleuze, G. & Guattari, F. (2003). Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Éd. Minuit.
Téléchargements
Références
Aubouin, N. et al. (2010). Médiation culturelle : l'enjeu de la gestion des ressources humaines. Ministère de la Culture, DEPS, coll. Culture études (n°1). pp. 1-12. En ligne : https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2010-1-page-1.htm (Consulté le 13 juin 2023)
Besson, R. (2021) Bâtir une culture de la coopération. Nectart (N° 12).
Ciosi, L. (2022). Des dispositifs frontaux aux dispositifs génératifs d’émancipation et de sens commun en médiation culturelle des arts. In. Butel, Y. (sous la dir. de), La frontalité … et l’effet méduse, Aix-en-Provence, Éd. Presses universitaires de Provence, coll. « Incertains Regards » n°11.
Citton, Y. (2020). Faire avec. Conflits, coalitions et contagions. Monts, Éd. Les liens qui libèrent, coll. Trans.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2003). Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Éd. Minuit.
Dewey, J. (2003. 1ère édition en 1927). Le public et ses problèmes, trad. J. Zask, Publications de l’Université de Pau. Ed. Léo Scheer.
Latour, B. (1988). La vie de laboratoire. Paris, Éd. La Découverte.
Mathieu, I. (2009). Introuvable médiateur culturel. In Les processus de construction identitaire en Sciences de l’Information-Communication Journée d’étude CIMEOS pour doctorants et jeunes chercheurs (pp. 1–10). Dijon.
Morizot, B. (2020). Manières d’être vivant. Arles, Éd. Acte Sud.
Serain, F. et al., dirs. (2016). La Médiation culturelle : cinquième roue du carrosse ? Paris, Éd. L’Harmattan, coll. Patrimoines et sociétés
Stengers, I. (2020). Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle. Paris, Éd. La Découverte.
Suzanne, G. (2022). Esthétique de la médiation. Approche historique, théorique et critique d'une pratique et d’une notion. Aix-en-Provence, Éd. Presses Universitaires de Provence.
Whitehead, A. N. (1995. 1ère édition en 1929). Procès et réalité, Paris, Éd. Gallimard.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés Laure Ciosi 2024

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Os artigos da revista Da Investigação às Práticas: Estudos de Natureza Educacional estão licenciados conforme Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação. Os artigos estão simultaneamente licenciados sob a Creative Commons Attribution License que permite a partilha do trabalho com reconhecimento da sua autoria e da publicação inicial nesta revista.
Os autores têm autorização para disponibilizar a versão do texto publicada na Da Investigação às Práticas: Estudos de Natureza Educacional sem custos em repositórios institucionais ou outras plataformas de distribuição de trabalhos académicos (p.ex. ResearchGate), com a devida citação ao trabalho original.
A revista não aceita artigos que estejam publicado (exceto sob a forma de resumo ou como parte de uma tese), submetidos ou sejam submetidos durante o processo editorial a outras revistas ou publicações. Após publicado o artigo não pode ser submetido a outra revista ou publicação parcial ou totalmente sem autorização da coordenação editorial da Investigação às Práticas: Estudos de Natureza Educacional.

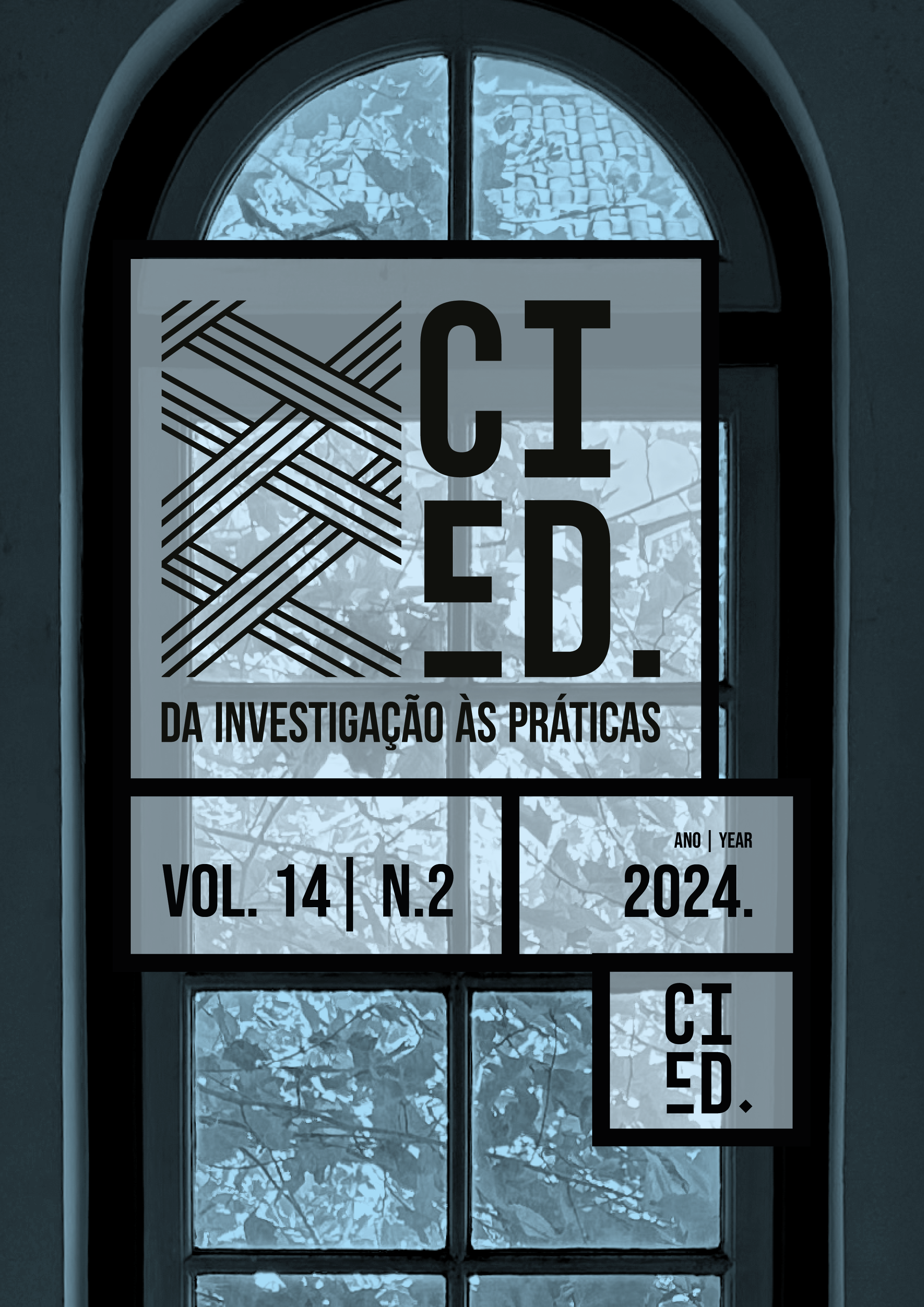



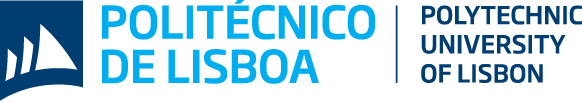 e-ISSN: 2182-1372
e-ISSN: 2182-1372